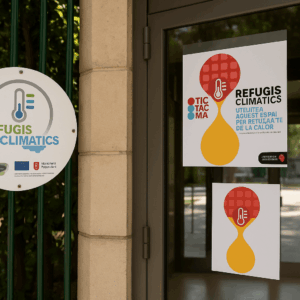La bactérie qui a brûlé les oliveraies d’Europe du Sud n’a pas atteint la Tunisie. Mais le climat qui change, les insectes vecteurs et un commerce des végétaux trop poreux resserrent l’étau — avec, à la clé, le sort d’un million de personnes.
À l’aube à Sfax, des canopées argentées ondulent au-dessus des terrasses de pierre. Un oléiculteur inspecte les jeunes pousses à la recherche des plus infimes trahisons : des pointes qui s’enroulent, une sève qui ternit, un liseré bronze au bord d’une feuille. Il traque une absence : la bactérie invisible qui a déjà déformé des paysages tout autour de la Méditerranée. La Tunisie est encore indemne de Xylella fastidiosa. Mais, saison après saison, le lancer de dés paraît moins clément.
État des lieux
En août 2025, la Commission européenne classe toujours la Tunisie parmi les pays officiellement reconnus comme exempts de Xylella au titre du régime phytosanitaire de l’UE, un statut chèrement défendu. Pourtant, les foyers détectés dans des régions européennes depuis 2013, associés à une pression croissante des vecteurs, ne laissent guère de marge à l’erreur.
Xylella, c’est quoi et pourquoi est-ce si difficile à arrêter ?
Xylella fastidiosa est une bactérie du xylème transmise par des cicadelles (notamment les « cicadelles écumeuses », famille des Aphrophoridae) et d’autres hémiptères piqueurs-suceurs. Elle peut infecter des centaines d’espèces végétales olivier, amandier, vigne, agrumes… et il n’existe pas de traitement curatif une fois l’arbre atteint. La réponse tient en un mot : vitesse ; détecter, contenir, arracher, indemniser.

Pourquoi la Tunisie est exposée
La géographie et le climat font une partie du travail. La Sicile et d’autres zones infectées ne sont qu’à quelques encablures de mer ; les ceintures semi-arides de l’intérieur offrent, au printemps et au début de l’été, des conditions favorables aux vecteurs. S’y ajoute le commerce : des flux, licites ou « gris », de plants, boutures et greffons pouvant faire passer des pathogènes entre les mailles des contrôles.
Des travaux de terrain dans les vergers tunisiens ont déjà cartographié le risque. Une enquête multi-régions (2018–2021) a piégé 3 758 Aphrophoridae sur 9 702 insectes échantillonnés, avec Philaenus tesselatus et Neophilaenus campestrisdominants sur l’olivier et des hôtes sauvages voisins — une écologie prête à la dispersion si la bactérie arrive.
Des défenses solides mais pas invincibles
Depuis 2015, la Tunisie a déployé un maillage national de surveillance sous l’égide de la Direction générale de la santé végétale (DGSV), appuyé par des diagnostics PCR à l’INRAT et à l’Institut de l’Olivier. Les inspecteurs et agents de vulgarisation ont été formés à l’échantillonnage et au signalement rapides ; des partenaires internationaux (FAO, CIHEAM, EPPO) ont soutenu des exercices de table et de terrain. En mai 2025, l’EPPO et la NEPPO ont mené à Hammamet un atelier de trois jours pour tester grandeur nature les protocoles d’urgence Xylella. Mais des failles subsistent. Des poches de petits exploitants échappent encore à la couverture ; les moyens humains et logistiques sont étirés sur un territoire oléicole immense ; les campagnes de sensibilisation restent inégales selon les régions. Le matériel végétal illégal ou mal certifié demeure une porte dérobée. Autant de coutures qu’une épidémie végétale rapide sait exploiter.
Ce qui est en jeu
L’olivier est la colonne vertébrale économique et l’emblème culturel de la Tunisie : 1,8 million d’hectares, 88 millions d’arbres, plus de 300 000 exploitations. La filière génère environ 40 % des exportations agricoles et fait vivre près d’un million de personnes, directement ou indirectement. Une incursion de Xylella à grande échelle ne serait pas une simple « secousse sectorielle » : ce serait un choc d’identité nationale.
Que faire maintenant
- Verrouiller les “frontières du vivant”. Renforcer les contrôles des passeports phytosanitaires et les audits aléatoires des pépinières ; cibler les espèces et origines à haut risque ; endiguer le marché informel de jeunes plants. Utiliser des kits rapides LAMP/qPCR pour un tri sur le terrain et réserver la capacité des labos aux confirmations.
- Muscler le “dernier kilomètre”. Financer un suivi saisonnier des vecteurs dans et autour des vergers (bords de routes, jachères, haies). Former des « sentinelles agriculteurs » à reconnaître les symptômes et à déclarer via un formulaire standardisé, avec des boucles de retour d’info qui créent la confiance.
- Combler le déficit d’outreach. Co-concevoir les messages avec les coopératives et les groupes de récolte féminins ; rémunérer le temps de formation des agriculteurs ; diffuser des alertes SMS/WhatsApp calées sur la phénologie des vecteurs.
- Pré-activer l’indemnisation. Publier un protocole lisible : quand les arbres sont arrachés, sous quel délai tombent les paiements, et quelles options de replantation existent — pour que le signalement précoce ne ressemble pas à une auto-sanction.
- Répéter l’urgence. Multiplier les exercices inter-services (ports, pépinières, labos, gouvernorats) jusqu’à automatiser les rôles ; capitaliser les leçons d’Hammamet pour colmater les points faibles.
Même si la Tunisie tient la ligne, des étés plus chauds et plus secs, des pluies plus erratiques, continueront de favoriser la dynamique des vecteurs et le stress hydrique des plantes. La meilleure défense du pays est celle qu’il a déjà commencé à bâtir mais plus vite, plus équitablement, au plus près des parcelles. Protéger l’olivier, ce n’est pas de la nostalgie : c’est du réalisme économique, de l’adaptation climatique et de la survie culturelle réunis.
Repérez-la. Signalez-la. (pour oléiculteurs et pépiniéristes)
- Premiers symptômes sur olivier : brûlure foliaire à partir des pointes/bords, liserés « grillés » avec un tissu encore vert le long de la nervure centrale ; dépérissement de rameaux ; ralentissement de la croissance. (Aucun symptôme n’est diagnostique à lui seul — prélever toujours des échantillons.)
- Vecteurs à surveiller : cicadelles écumeuses (Aphrophoridae) sur les graminées sauvages au printemps ; les adultes gagnent les arbres à mesure que la végétation herbacée sèche. Évitez de faucher les plantes-hôtes sauvages tant que les vecteurs ne les ont pas majoritairement quittées, pour ne pas provoquer des envols massifs vers les oliviers.
- En cas de suspicion : relever les coordonnées GPS ; photographier plusieurs feuilles/rameaux ; isoler le matériel végétal ; contacter la DGSV via les services régionaux ou le point de contact national (IPPC). Ne pas déplacer de plants suspects hors site.

Copyright: FAO
Copyright © 2025 Blue Tunisia. All rights reserved
Réferences:
- https://food.ec.europa.eu/plants/plant-health-and-biosecurity/trade-plants-plant-products-non-eu-countries/declarations-non-eu_en?utm_source=chatgpt.com
- https://www.agritunisie.com/xylella-fastidiosa-une-menace-imminente-pour-les-oliviers-tunisiens/?utm_source=chatgpt.com
- https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9563?utm_source=chatgpt.com
- https://www.anses.fr/fr/content/xylella-fastidiosa-une-menace-pour-les-oliviers-et-des-centaines-de-plantes?utm_source=chatgpt.com
- https://www.iosfax.agrinet.tn/